Alain BARTHES – Correspondant Académique
La nouvelle équipe d’animation :
Le renouvellement du bureau national a
entraîné des changements.
Hélène RABATE, proviseur de Lycée,
membre du bureau national, assure maintenant la responsabilité nationale de
cette commission en remplacement de PHILIPPE TOURNIER, promu
Secrétaire général adjoint.
Elle est aidée par :
Catherine GUERRAND, Catherine PETITOT,
Catherine DAUNY et Jean-Claude LAFAY, tous membres du bureau national.
Les travaux de la commission
pendant le congrès :
Plus de 80 personnes, issues de toutes
les Académies ont participé aux travaux.
L’Académie de MONTPELLIER était représentée par
Michel BESSEGE, Georges DE HARO, Serge PIOLI et Alain BARTHES.
Malgré une salle exiguë, vu le nombre de
participants, les débats ont été riches, parfois contradictoires, toujours
d’un bon niveau.
Nous sommes intervenus de nombreuses
fois sur la base des motions votées à l’AGA de MAGALAS et nous avons été
entendus, même s’il reste encore beaucoup de travail à faire et des
amendements à apporter :
Vous trouverez ci-après les textes de
ces motions adoptées par le congrès :
-
motion n°1 :
demande à la représentation nationale de fixer les objectifs et garantir les
moyens
-
motion n°2 :
concerne l’enseignement professionnel
-
motion n°3 :
sur les principes de mise en œuvre des réformes
-
motion n°4 :
sur les TPE
-
motion n°5 :
concerne l’enseignement supérieur des Lycées.
-
Texte sur l’éducation et la
formation tout au long de la vie (texte initié par Philippe TOURNIER)
Amitiés syndicales.
Alain BARTHES
Commission
Education et Pédagogie
MOTION N°1
La commission
pédagogique réunie en congrès à Nantes demande une nouvelle fois à la
représentation nationale de définir les missions et les objectifs qu’elle
assigne à son Ecole et plus particulièrement au collège.
Il faut
constater en effet que les différentes tentatives de réformes n’ont pas
permis d’améliorer les conditions de réussite de chacun des élèves.
Une fois les
missions et les objectifs clairement identifiés et énoncés, le SNPDEN
demande à la Nation de garantir les moyens de leur mise en œuvre.
MOTION N°2
Le congrès
prenant en compte les enjeux de l’enseignement professionnel et
technologique accepte le principe du Lycée des Métiers et demande que son
application respecte les principes suivants :
1.
Développement du service public
garant de la cohérence des offres de la formation tout au long de la
vie (lycées polyvalents, professionnels, CFA publics, GRETA, EREA, LEA)
2.
Labellisation assurée par une
autorité libre des pressions locales et des lobbies, réalisée après
concertation sur des bases contractuelles et dans le respect des objectifs
et des diplômes de l’Education Nationale.
3.
Cohabitation des différents
statuts des personnels et des publics accueillis.
4.
Développement des passerelles
pédagogiques et préservation du maillage géographique.
5.
Assurance que tous les
établissements, labellisés ou non, bénéficieront des moyens nécessaires à
une réelle promotion de tous leurs élèves.
Il demande
que soit recherchée systématiquement les échanges permettant de coordonner
les positions syndicales européennes sur ces questions.
MOTION N°3
Le congrès se
déclare favorable à l’esprit et aux principes sous-tendant les nouvelles
mesures contenues dans les réformes du collège et des lycées.
Cependant il
exige avant toute mise en œuvre de réformes :
·
L’organisation d’une véritable
concertation avec les personnels de direction.
·
La définition d’un calendrier
en cohérence avec le fonctionnement des EPLE.
·
L’évaluation et la diffusion
des dispositifs expérimentés.
·
L’accompagnement des équipes
enseignantes par les corps d’inspection
·
L’attribution des moyens
nécessaires à leur mise en œuvre.
MOTION N°4
Le SNPDEN
reconnaissant l’intérêt pédagogique de la démarche TPE, et prenant
connaissance des dernières dispositions ministérielles leur conférant un
caractère de préparation obligatoire en classe terminale des séries
générales, demande qu’ils fassent l’objet d’une évaluation elle aussi
obligatoire au baccalauréat.
Constatant
les difficultés rencontrées dans de nombreuses académies lors de la première
mise en place pour la session 2002, il demande que cette évaluation
s’effectue sous la forme d’un contrôle en cours de formation.
Il rappelle
que l’évaluation des TPE relève d’un examen à caractère national et qu’il
appartient aux services académiques d’en assurer la complète organisation
comme pour toutes les autres épreuves du baccalauréat y compris les épreuves
facultatives.
MOTION N°5
Les classes d'enseignement supérieur des lycées
Le SNPDEN, réuni en congrès, rappelle que les E.P.L.E.
accueillent aujourd'hui, dans les S.T.S. principalement, mais aussi dans les
C.P.G.E. et dans les écoles de métiers, 30% des étudiants du premier cycle
de l'enseignement supérieur. Le SNPDEN tient à promouvoir, à ce niveau
également, son objectif général de démocratisation du système éducatif.
C'est pourquoi il estime nécessaire :
1°) de faire reconnaître, à leur niveau d' importance réelle
et dans leur spécificité, par les autorités de tutelle et par les
collectivités territoriales, l'existence des classes supérieures de lycée;
d'obtenir l'identification des responsables du pilotage de ces classes, qui
actuellement n'est pas pleinement assuré ;
2°) de travailler à une cohérence de réseau de préférence à
une logique de libéralisme fondée sur la
concurrence entre établissements; d'obtenir notamment, pour les C.P.G.E.,
une révision de la procédure d'affectation, dans le .sens de la
transparence, de l'équité, et d'une meilleure répartition des élèves ;
3°) d'obtenir un projet de cadrage des missions des classes
de S.T.S. et C.P.G.E., en référence aux objectifs généraux de l'enseignement
supérieur, pour contribuer « à la réduction des inégalités sociales ou
culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes
en assurant à toutes celles et tous ceux qui en ont la volonté et les
capacités l' accès aux formes les plus élevées de la culture et de la
recherche » (article L.123-2 du Code de l'Education) ;
4°) d'obtenir la prise en compte dans la gestion académique
des difficultés particulières des élèves les plus défavorisés, (y compris
lorsqu'ils sont minoritaires dans une population scolaire privilégiée), en
tenant compte de leurs conditions d'études (par l'affectation d'une part
spécifique des fonds sociaux, par l'organisation du service social, de santé
scolaire, etc.) ; de faire définir les objectifs et les moyens en termes
d'hébergement (cohérence de la carte des internats, accueil des jeunes
filles, réponse aux besoins pour certaines spécialités des S.T.S.) ;
5°) dans la perspective de la validation des étUdes
entreprises dans nos lycées jusqu'au niveau bac+2 dans le cadre européen
(système des 120 E.C.T.S. sur les 180 qui définissent la qualification à bac
+3), d'obtenir que soient engagées les évolutions nécessaires pour obtenir
cette validation des 2 années d'enseignement supérieur en lycée : en ce qui
concerne les licences professionnelles, d'obtenir des garanties en matière
de débouchés pour nos diplômés B. T .S., de stabilisation des moyens
d'enseignement et de participation au processus de validation, dans le cadre
des conventions passées ou à passer avec les universités ;
6°) de faire identifier la cohérence entre les missions de
ces classes, les missions assignées aux chefs d'établissement, et les moyens
(y compris réglementaires) mis en reuvre (par exemple, les obligations de
surveillance, de contrôle d'assiduité, de sécurité des internats, de lutte
contre le bizutage, correspondent à des tâches réelles qui impliquent
diverses catégories de personnel; la création d'associations d'étudiants
pour gérer dans nos lycées des éléments de pratique commerciale inscrites à
leur programme est discutable en droit) ;
7°) de faire mettre en place au niveau académique les outils
de pilotage et d'évaluation, en particulier statistiques, en distinguant
dans les lycées les classes avant et après le bac ;
8°) de lancer la réflexion sur l'évolution du statut des
élèves de classes supérieures de lycée (STS, CPGE) : nous sommes pour une
définition spécifique de nos responsabilités par rapport à ces élèves, et
pour leur représentation directe comme usagers dans les Conseils
d'Administration ;
9°) de faire reconnaître le principe d'une adaptation des
programmes et des pratiques pédagogiques dans les classes supérieures de
lycée, en fonction des objectifs affichés.
L'EDUCATION ET LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
L'évolution de la société induit la mise en place
de systèmes de formation capables d'anticiper, de réguler, de
gérer les conséquences du progrès technique et des nouveaux
processus économiques. Mais, dans un même temps, cette société
éducative doit permettre à chaque citoyen d'accéder à de nouvelles
connaissances tout au long de sa vie et de s'en prévaloir afin
d'en obtenir un progrès social.
A partir d'une culture commune, ...
La culture commune est d'abord constituée d'un « socle
indispensable », incontournable par tous et donc accessible à tous.
Garanti par le service public à la société, la formation dispensée au
collège ne s'y limite pas: si tous doivent l'acquérir, la plupart a
des « compétences au delà ». La certification du « socle indispensable
» et l'évaluation des « compétences au delà » doit se faire selon des
critères nationaux qui peuvent prendre en compte des apports européens
et internationaux. Une telle approche suppose qu'elle soit aussi en
place en fin de l'école primaire et, d'une façon générale, qu'elle
soit l'approche la plus générale à tous les niveaux de formation: le
système éducatif doit être défini par ses objectifs d'apprentissage
-les exigences minimales, les codes culturels et sociaux et les
compétences parliculières- et non le détail des modalités
organisationnelles de mise en csuvre qui n'assurent ni que les
objectifs soient atteints, ni que l'égalité de traitement attachée à
la notion de service public soit garantie dans la réalité.
Le contrat du « socle indispensable » entre l'école et
la société étant éclairci (100% d'une génération ayant 100%
des éléments du «socle indispensable»), c'est aux acteurs qu'il
convient de laisser le soin de définir la meilleure méthode à
l'occasion d'un projet doté d'un contenu pédagogique rendant
particulièrement nécessaire l'existence d'un conseil pédagogique dans
les EPLE.
L'Etat garantit à chaque unité des moyens (HP et HSA)
d'un horaire minimal (par « structures de référence
» : classe, modules, etc.) plus un pourcentage significatif
(10% et plus) de moyens, partout identique, à charge pour
chacun de définir les meilleures solutions. A cette dotation nationale
s'ajouteraient des moyens académiques ou départementaux alloués sur
une base contractuelle (qui ne soit pas biaisée) permettant de
les identifier.
L'émergence de la culture commune, et en particulier le
certification du « socle indispensable », est normalement atteinte au
collège, de toute façon au terme de la scolarité obligatoire et avant
toute orientation ultérieure.
...des formations
initiales certifiantes. ..
A l'issue du collège, l'offre de formation est alors
donnée par des lycées « polymorphes » qui présentent, dans un même
lieu ou sous forme de réseaux, tous les types de formation. Cette
structure permet l'accueil de publics à statuts divers, pas
nécessairement en même temps et selon des modalités pédagogiques
identiques: il ne s'agit pas de dilater la seconde GT à l'échelle
d'une génération toute entière.
L'avantage de cette structuration est de donner un
contenu à 1'« égale dignité des formations ». La fluidité des parcours
est améliorée dans la mesure où ce sont les objectifs des formations
deviennent le centre de gravité du système, et non les parcours pour
eux-mêmes.
Le principe de la « marche en avant » continue de la
scolarité peut y être associée en se basant sur deux principes :
-celui de la fluidité des parcours au sein de lycée
entre les diverses voies de formation dont nous restons extrêmement
loin dans la pratique par la multiplication des obstacles de toutes
natures
-celui de la capitalisation déjà affirmé au CSN de
Valence, y compris celle « des erreurs » dès qu'elles peuvent
être « reconnues comme une part du cheminement de formation ».
Une telle stratégie éducative suppose en effet la
capitalisation des acquis scolaires qui règle la question des
redoublements tel que nous les connaissons. Elle induit de nouvelles
pratiques pédagogiques ce qui a des conséquences sur les programmes et
sur le métier d'enseignant. De même, le statut des élèves devra être
repensé dans le cadre d'un réflexion sur l'autonomie de la jeunesse.
Le corollaire de ce nouveau lycée peut être une
interrogation de la forme actuelle du baccalauréat mêlant sans les
dissocier la certification d'études secondaires diverses et le premier
garde universitaire. Cela ouvre deux objets de débats :
-./ Jusqu'où la construction d'un parcours
individuel peut-elle aller ? Comment y assurer l'égalité des chances
et éviter les « délits d'initiés » ? Dans une telle hypothèse,
qu'est-ce que la culture commune générale ? Quelle forme et quelle
meilleure adéquation entre le baccalauréat et l'enseignement supérieur
? .
-./ Dans un système souple et ouvert, quels modes
d'organisation qui ne transforment pas la vie quotidienne des
personnels de direction en un enfer ?
...et une professionnalisation permanente.
La formation continue n'est pas dissociable de la
formation initiale et une véritable continuité entre la formation
initiale et la formation continue passant par le principe d'un «
capital formation incluant la formation initiale permettant d'en
corriger les effets et utilisable tout au long de la vie » déjà
retenu
par le syndicat. Ainsi pourrait-on quitter la formation
initiale avec de diplômes complets ou partiels et, dans ce dernier
cas, les compléter par de la formation continue au sein des
établissements (ce qui supposerait une plus grande souplesse
d'organisation et d'allocation des ressources) et la validation des
acquis de l'expérience. .
/ Quelles formes d'articulation (personnels,
financements, gestion, etc.) entre la formation initiale et les autres
modalités ?
/ Comment et jusqu'ou assurer la diversité des
publics dans un même lieu ?
/ Peut-on concevoir des formes intermédiaires de
scolarisation ?
Les GRETA, dans leur version d'aujourd'hui, se
débattent dans des logiques contradictoires: celle du service publique
et celle de la concurrence sur un marché de formation où ils
rencontrent d'autres formations continues publiques.
/ Quels évolutions des GRETA pour assurer la
continuité entre formation initiale et continue au sein des
établissements ?
/ L'existence de plusieurs organismes de formation
continue émanent de ministères différents doit-il laisser place à un
opérateur public unique ?
La définition de repères précis (diplôme,
certification, qualification) assignés à toute formation et la
validation de l'expérience demande qu'un organisme régulateur national
« sécurise » les
qualifications et les diplômes en les reconnaissant :
/ Le MEN peut-il être et/ou doit-il être cet
organisme ?
:
/ Faut-il s'orienter vers le concept de « labellisation » ? A étendre
partout et à tous ?
/ Comment peut-on articuler diplômes européens et de
qualifications liées à des pratiques locales
Vote indicatif :
Pour : 74
Abstention : 4
Contre : 1 |
Commission Vie Syndicale
La commission regroupait 82 collègues, Michèle DEVAUX,
Jean-Paul TEILLOL, Jean-Pierre BESSIE, Rémi BÉLET, y représentaient la section
académique de Montpellier.
è
La commission a étudié les points suivants : la modification des
statuts et du règlement intérieur, la situation actuelle de notre syndicat et
les évolutions nécessaires notamment en matière de relations avec les
syndiqués et de formation des cadres syndicaux, la laïcité.
Les textes adoptés par le congrès seront
prochainement publiés dans « Direction ».
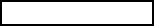
Quelques points forts
è
Il a été décidé de remettre à l’étude des prochains C.S.N. la question
des modalités de désignation des représentants directs aux C.S.A.
tant les pratiques varient selon les sections académiques, c’était une demande
de l’académie de Montpellier.
è
Il a été demandé une communication par la Commission Nationale de
Contrôle sur l’application des statuts et du règlement intérieur
dans nos sections départementales et académiques .
è
Pour ce qui concerne l’analyse du fonctionnement de notre syndicat et
nos perspectives d’action le rapporteur s’est largement référé aux
analyses conduites par la section académique de Montpellier ce qui
laisse bien augurer du travail d’investigation et des propositions qui feront
l’objet d’une réflexion dans le syndicat pendant les 2 ans à venir.
è
La formation des cadres syndicaux mais aussi la sensibilisation à la
pratique syndicale de chaque adhérent et en particulier des nouveaux
nommés ont suscité de nombreuses propositions et feront l’objet d’une
mobilisation particulière à tous les niveaux de notre organisation. C’est
essentiel quand on sait que d’ici 2007 plus de 5500 collègues partiront à la
retraite.
è
Les élections professionnelles qui se dérouleront en décembre 2002
représentent une échéance importante pour le SNPDEN, c’est un rendez-vous
syndical qui doit être réussi avec l’ensemble des personnels de direction,
dans cette perspective une charte académique devra être élaborée.
è
La vie démocratique de notre syndicat passe aussi par une bonne
communication . Il s’agit d’informer rapidement les syndiqués mais
aussi , pour certaines questions, l’ensemble de nos collègues. A cette fin le
site Internet national doit devenir , au même titre que notre revue
« Direction », l’expression du S.N.P.D.E.N. .Les sections académiques sont
invitées à ouvrir leur propre site et à utiliser pleinement les
possibilités d’interactivité qui sont alors offertes.
è
Un texte précisant clairement notre conception de la laïcité a été
adopté par le congrès , c’est à la fois une référence indispensable
pour notre action syndicale et une affirmation forte de notre identité.
La grande majorité des
orientations adoptées par le congrès de Nantes figuraient dans les
contributions produites par notre section académique ce qui tend à confirmer
la qualité de notre réflexion collective. Il nous appartient maintenant de les
enrichir et surtout de les décliner au quotidien en gardant présent à l’esprit
qu’un syndicat est ce qu’en font les syndiqués.
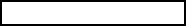
Notre action dès à présent
è
Préparer avec soin les élections à la C.A.P.A.
è Nous approprier dans les
assemblées départementales et académiques le texte sur la « Laïcité »
le populariser et le mettre en application dans nos pratiques professionnelles
et syndicales.
è Poursuivre notre réflexion sur
le travail d’investigation à conduire
Ø
pour analyser notre pratique syndicale
Ø
pour améliorer la communication de notre section académique et de nos
départementales
Ø
pour faire vivre nos groupes de réflexion thématiques , notre forum internet
Ø
pour mettre en place « les séminaires thématiques » dont le principe a été
adopté à l ‘AGA de MAGALAS
Ø
pour prendre toute notre place de syndicalistes dans le débat sur les grandes
questions qui se posent à notre
société.
è
… et contribuer ainsi à ce que le S.N.P.D.E.N. continue à être
Ø
un lieu
d’échanges,
Ø
une force de
proposition - et de contestation lorsque c’est nécessaire ,
Ø
le meilleur
défenseur des intérêts matériels et moraux de notre profession ,
Ø
le syndicat
unitaire des personnels de direction , interlocuteur incontournable de l’Etat,
des collectivités territoriales et de nos partenaires sociaux.
COMMISSION
CARRIERE AU CONGRES DE NANTES
Ont participé aux
travaux:
Jacqueline Vigneron-Vanel, Anne Marie Brugeas, Nicole Sandrin, Roger Chamayou,
Joel Charton, Pierre Javelas.
Les questions
traitées ont été les suivantes:
-
Avenir
des pensions et retraites
-
Actualité
du statut:
-
Pyramidage vers le corps unique
-
Classement
des établissements
-
Indemnités et NBI
-
Mobilité
-
Mutations
-
Formation initiale
-
Prospective.
Commentaires:
-
Les
thèmes abordés par la commission carrière l'ont été sur un plan corporatiste
plus que politique (contrairement au congrès de Toulouse), ce qui n'est pas
étonnant au lendemain de la mise en place du nouveau statut.
-
Les
motions ont été très consensuelles et n'ont pas suscité de polémique
(contrairement au congrès de toulouse où nous étions en période de
négociation du nouveau statut)
-
Il faut
que le syndicat digère le nouveau statut: plusieurs points ne sont pas assez
approfondis: mobilité, classement des établissements, pyramidage, accession
au corps unique.
-
Certains chantiers ouverts depuis longtemps n'ont pas avancé (NBI, formation
initiale) plus par manque de recul et d'approfondissement que par manque de
pugnacité syndicale.
-
L'académie de Montpellier doit travailler sur l'ensemble de ces dossiers qui
n'ont pas fait l'objet d'une réflexion suffisante (notre commission carrière
a beaucoup travaillé sur notre ARTT, qui a été finalement confiée à la
commission métier au congrès)
-
La
nouvelle méthode de travai adoptée par le CSA (commissions préparatoires)
doit nous permettre de mener à bien ces tâches
-
Les
départementales doivent soumettre ces sujets à leur ordre du jour dès la
rentrée.
-
Les
mandats de l'Académie de Montpellier ont été repris sous des formes diverses
par les motions de congrès, et portent sur les points suivants:
-
Pyramidage et corps unique
-
Classement des établissements
-
Rémunérations complémentaires
-
Mobilité
-
Mutations
-
Formation initiale
-
DESS de
Direction
-
Fin de
carrière et pensions
Le texte intégral
des motions de congrès paraîtra dans le prochain "DIRECTION", et est
accessible sur le site national.
Prospective
Le syndicat a eu la
lucidité d'évoquer quelques lignes prospectives pour l'avenir en matière
d'évolution de carrières.
Cette nécessité est
d'autant plus grande que le renforcement de la décentralisation conduira à une
plus grande responsabilisation des cadres, et que l'on risque d'aller vers une
unification, ou un rapprochement des statuts de l'encadrement supérieur
(certainement dans le cadre européen).
Que peut envisager
le SNPDEN dans cette évolution?
-un corps unifié de direction inter-fonction publique?
-une attractivité financière garantie dans ce nouveau corps élargi?
-Avec quelle contre-partie? Mobilité entre emplois? A l'intérieur d'un corps?
Inter fonctions publiques?
-Quelles conséquences sur les classements? Sur les promotions? Sur les
mutations?
-quid des pensions?
Le congrès a décidé
de mettre en place une commission au niveau national pour faire des
propositions au prochain congrès de Toulon en 2004.
haut de page
Commission Métier
La Commission
Métier réunit comme toujours un grand nombre de participants ( 116 )
représentant l’ensemble des académies ( même la Guyane ).
Les animateurs
ont proposé le questionnement suivant :
Les
représentants de l’Académie de Montpellier comme de nombreux autres, ont
demandé avec force que « l’ARTT » soit traitée en même temps que « les
conditions d’exercice du métier » puisqu’une ARTT réelle devrait permettre
d’améliorer ces conditions.
Les animateurs
ont refusé cette proposition et maintenu leur ordre de traitement des
questions.
Dans chaque
rubrique des motions ont été proposées et votées .
Deux d’entre
elles, celle sur la violence et violents et sur l’ARTT, ont eu pour base les
motions proposées par l’Académie de Montpellier et ont été adoptées à
l’unanimité par la Commission puis par le Congrés.
Le travail
préparatoire au Congrès accompli au cours des différents CSA et des AGA a
permis à notre Académie de faire des propositions de motions très abouties qui
ont pu être reprises presque en l’état. C’est la reconnaissance du travail
accompli.
I - Les conditions
d’exercice du métier
MOTION 1 : l’application du
protocole
La commission METIER rappelle l’attachement du
S.N.P.D.E.N. à la mise en œuvre, dans toutes les Académies, des dispositions
contenues d’une part dans le titre III du Protocole intitulé « Méthode sur le
diagnostic de l’établissement et la lettre de mission », d’autres part dans la
note de cadrage de la DPATE.
Le dispositif Diagnostic/lettre de
mission/Evaluation des Personnels de Direction doit obligatoirement faire
l’objet d’un suivi par le groupe de travail permanent constitué auprès du
Recteur dit « Groupe Blanchet »
Le choix des indicateurs du diagnostic relève
de la responsabilité de la Direction.
La lettre de mission est individuelle.
Celle du chef d’établissement doit être
rédigés et signée par le Recteur. Elle est contresignée par le chef
d’établissement.
MOTION 2 : diriger un
établissement
Les
Personnels de Direction doivent faire face à des problèmes multiples de
nature humaine, matérielle, statutaire, réglementaire, qui revêtent
également une diversité liée à celle du fonctionnement des différentes
Académies.
Dans ce cadre, la commission METIER
affirme que les conditions de travail des Personnels de Direction sont de
plus en plus inacceptables.
C ‘est pourquoi la commission METIER
demande au Bureau National de créer un groupe de travail national et
transversal chargé de synthétiser les plate-formes revendicatives issues des
Académies, d’apporter des solutions cohérentes qui permettront à chaque
Académie d’avoir une base commune laissant la place nécessaire au traitement
des spécificités locales.
Les textes rédigés après discussion
académique seront soumis au C.S.N de novembre 2002.
II
- MOTION 3 : LA VIOLENCE ET LES VIOLENTS
1- Dans de nombreux établissements, des
phénomènes de violence, ponctuels ou répétés, se développent. La commission
METIER rappelle que le traitement de la violence passe d’abord par la
réaffirmation et la défense des valeurs fondamentales de la République. Ces
valeurs ignorées ou rejetées par un certain nombre d’élèves -
pas toujours partagées par les
adultes- -
sont souvent non transmises ou
bafouées.
Les missions de 1 ‘Ecole et de tous ses
acteurs doivent être solennellement redéfinies par la Nation.
2 - Une prévention et un traitement
efficace de la violence en milieu scolaire supposent:
Que les équipes de Direction et
les équipes éducatives soient complètes et renforcées afin que les Personnels
de Direction ne soient pas seuls en charge de la politique disciplinaire et qu
‘ils puissent recentrer leur action sur leur mission pédagogique;
Que la coopération avec les partenaires
extérieurs (police, justice, gendarmerie, associations...) soit effective
sur la base d‘objectifs partagés et réactivés dans un cadrage national et
académique;
Que la formation de tous les acteurs du
système éducatif prenne en compte véritablement la gestion des conflits et
la problématique de la violence,•
Que soient redéfinies les modalités
de recrutement et de formation des personnels de surveillance;
Que soient créés des dispositifs
adaptés pour 1 ‘accueil et le traitement des élèves violents,~
Que la gestion de la carte scolaire
ne conduise pas à la constitution d’établissements ghettos;
Que 1 ‘on renforce les moyens
matériels de surveillance des espaces de circulation et des entrée.
Que les instruments nationaux de mesure des
phénomènes de la violence en milieu scolaire permettent une appréciation à
la fois exacte et fine de la réalité vécue dans nos établissements.
III – MOTION
4 : A.R.T.T. DES PERSONNELS DE DIRECTION
La commission METIER prend acte de la
possibilité offerte aux Personnels de Direction de bénéficier des dispositions
du Compte Epargne Temps
(cf Décret n°2 002-634 du 29 avril 2 002).
La commission METIER refuse catégoriquement
que 1 ‘A. R. T T. des autres catégories de personnels se traduise par un
accroissement du temps et de la charge de travail des Personnels de Direction.
La commission METIER réaffirme notre
volonté de voir reconnu notre droit
à un aménagement et à une réduction
de notre temps de travail.
La commission METIER demande que les
Personnels de Direction aient la possibilité de définir les modalités
spécifiques de 1 ‘Aménagement et de la Réduction de leur Temps de Travail.
La commission METIER mandate le Bureau
National pour qu ‘il poursuive la négociation sur
1 ‘A. R. T. T des Personnels de Direction.
Cela ne doit pas exclure nos revendications antérieures
relatives
à la Cessation Progressive d ‘Activité et
au maintien du dispositif de Congé de Fin
d ‘Activité.
Vote indicatif de la commission
Adoptée à l’unanimité moins une abstention.
IV - MOTION 5 :
DECENTRALISATION ET DECONCENTRATION
La commission METIER réaffirme le profond
attachement du SNPDEN. à une définition de la politique éducative dans le
cadre du Service Public National d ‘Education.
La commission METIER demande au Congrès de
constituer un groupe de travail chargé de mener une réflexion quant au devenir
du Service Public d ‘Education et de ses métiers, dans un contexte d’évolution
potentielle de la décentralisation. Ce groupe de travail devra fixer le cadre
et les limites d’évolution, notamment dans le respect du principe républicain
d’égalité et d’unicité de 1 ‘offre de formation sur Z ‘ensemble du territoire.
L ‘autonomie des établissements instituée
par les lois de décentralisation de juillet 1 983 et mise en oeuvre par le
Décret du 30 août 1985 ne saurait se limiter
à la seule gestion de ressources
financières déléguées par les Collectivités Territoriales. Une nouvelle étape
de la décentralisation devrait permettre des
marges de manoeuvres supplémentaires.
En matière de déconcentration, en sa
qualité de représentant de l ‘Etat, le Chef d’établissement, devrait disposer
de compétences accrues qui ne se limitent pas seulement
à un transfert de charges (à titre
d’exemple: bourses en collège).
haut de page