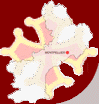 COMMISSION EDUCATION ET PEDAGOGIE
COMMISSION EDUCATION ET PEDAGOGIE
Alain BARTHES, Correspondant Académique
Qui compose la commission ?
La commission Education & pédagogie réunit sept membres du bureau national :
- Catherine Guerrand (chargée du suivi des collèges)
- Roland Guilley (chargé du suivi de la formation professionnelle)
- Patrick Hamard (chargé du suivi de l'enseignement adapté)
- Anne-Marie Oliver
- Marie-Noëlle Sereno
- Philippe Tournier (chargé de l'animation de la commission)
- Alain Val
Et dans les académies ?
La commission a des correspondants académiques qui reçoivent une information périodique par courrier électronique Echange. Les textes principaux sont publiés dans Direction.
Comment sont élaborés les orientations ?
La commission se réunit également lors des CSN et des Congrès. Elle groupe alors une cinquantaine de membres (avec une composition assez stable). Elle discute alors des mandats ou de textes d'orientation qui sont construits à partir des contributionsacadémiques ou départementales (d'où l'importance du travail académique).
Quelle méthode de travail ?
Depuis le congrès de Toulouse, la commission travaille autour de thèmes transversaux (et non plus avec des sous-commissions « collège », LP »etc). Elle s'appuie cependant sur des « expertises » techniques particulières pour certains domaines (les CPGE, etc.) ou si le travail de suivi de l'actualité est partagé entre les membres de la commission.
Le programme de travail de la commission
est à deux niveaux :
Définir des orientations de fond
et prendre des positions d'actualité.
I. QUESTIONS DE FOND
Deux grands thèmes sont programmés :
- actuellement "Egalité & diversité"; (qui doit donner lieu au vote d'un texte d'orientation au CSN de Valence)
- une réflexion sur "Comment un système démocratisé forme-t-il des élites ?"
.
Le thème « Egalité & diversité » est traité à partir de six questions posées aux académies et des réponses de ces dernières. Le CSN a abordé trois questions (L'intégration de tous les élèves est-elle un mythe ? Egalité et
décentralisation, Gratuité et égalité) et une réunion qui a eu lieu le 24 janvier pour balayer les trois restantes (Comment prendre en compte les différences sociales ? Qu'est-ce que l'égalité des chances ? Comment la répartition des moyens peut-elle contribuer à l'égalité ?).
A partir de là, une trame sera rédigée avec les académies avant d'être présenté au CSN. L'objectif de cette méthode est d'utiliser les nouvelles techniques de communication pour bâtir un texte collectivement, en continu et chacun à son rythme.
La même méthode sera mise en oeuvre sur le thème "comment un système démocratisé forme-t-il des élites ?" (en s'appuyant également sur l'expertise du groupe des CPGE). Ce thème peut surprendre pourtant il nous apparaît de plus en plus essentiel : ne discuter que de la démocratisation sans se soucier de la formation des
élites revient à admettre qu'elles se forment ailleurs qu'à l'école...
II. L'ACTUALITE
Parmi les thèmes d'actualité se trouvent trois questions :
- le devenir de l'enseignement professionnel
- la place de l'enseignement adapté
- l'évolution du collège.
Le devenir de l'enseignement professionnel est abordé « par le petit bout de la lorgnette », c'est à dire les
tables rondes (en particulier celle sur les grilles horaires) mais, au delà, se pose la question de sa place. Notre doctrine et celle du 'lycée' (ex-polymorphe !) et nous sommes peu favorables à la position de notre fédération
sur le lycée polytechnique (du fait de ses conséquences en matière de ségrégation sociale).
Cependant, les évolutions économiques en cours, si elles se confirment durablement, poseront la question de l'enseignement professionnel en des termes différents (il faut rappeler que nous sommes partisans, depuis longtemps, de l'apprentissage public).
La problématique de l'enseignement adapté est celle de savoir jusqu'à quel point il peut être intégré (le principe étant entendu).
En ce qui concerne le collège, la phrase 'le collège doit accueillir tous les élèves selon des modalités
différenciées', votée à Poitiers, reprise en 1997, confirmée à Toulouse, cadre notre position mais l'affiner est
aujourd'hui nécessaire. Voici un panorama de ce que pourrait être un développement plus précis de nos positions telles qu'il a été évoqué lors de la réunion de la commission du BN, les 19 et 20 décembre.
Pour une 'subsidiarité scolaire' :
A l'Etat, la certification ; à l'établissement,l'organisation.
La certification se ferait sur la base d'un « minimum assuré » et incontournable c'est-à-dire ce que le collège
garantit comme acquis par tout collégien qui le quitte (sauf ceux relevant de l'enseignement adapté). Ce 'minimum' est donc accessible à tous, garanti par le collège à la société mais la formation dispensée par le collège ne s'y limite pas : si tous doivent l'acquérir, la plupart devront avoir des compétences au delà, acquises au collège ou ailleurs. Le collège ne choisit pas ses collégiens, ne les évacue pas et garantit que tous le
quitte avec ce 'minimum'. La certification du 'minimum' et l'évaluation des compétences se feraient selon les critères nationaux. Une telle approche suppose qu'elle soit aussi en place en fin de l'école primaire.
Le contrat entre le collège et la société étant éclairci (100% des collégiens quittant le collège avec 100% des
« minima »), c'est aux acteurs du collège qu'il convient de laisser le soin de définir la meilleur méthode
(modules, traditions, etc) à l'occasion d'un projet doté d'un contenu pédagogique.
L'Etat garantit à chaque collège des moyens (HP et HSA) d'un horaire minimal (par « structures de référence » :
classes, modules, etc,) plus un pourcentage significatif (10% et plus) de moyens, partout identique, à charge pour chacun de définir les meilleures solutions (abandon des modèles organisationnels nationaux). A cette dotation
nationale s'ajouteraient des moyens académiques ou départementaux alloués sur une base contractuelle (REP, etc,) permettant de les identifier.
Le conseil pédagogique
Le conseil pédagogiques devrait d'abord être un lieu de débat (échanges de pratiques, information
interdisciplinaireŠ), d'étude de l'impact des choix pédagogiques (équipement, droit etcŠ), des besoins en formation et en animation. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté dans ses relations avec le C.A qui reste le lieu
décisionnel.
La composition de ce conseil doit rester souple (modalités décidées par le C.A.) dans un cadrage national ; il doit
comprendre absolument la direction et des représentants des professeurs, probablement la vie scolaire et documentaliste. La présence obligatoire du COP faisait débat.
Polémique & vraie question :
Les CO sont-il trop P ?
Jérôme Chapuisat, directeur de l'ONISEP s'interroge sur le développement "fort voire exclusif" de la part "psychologique" du métier de conseiller d'orientation, qui ne permet pas en général au Conseiller d'orientation Psychologue d'avoir une "bonne maîtrise de trois dimensions indispensables de sa compétence : l'éducatif,
l'économique et le social".
"Le conseil en orientation ne peut, bien sûr, pas faire abstraction de la singularité de chaque jeune, avec ses problèmes, ses aspirations, son environnement personnel". La dimension psychologique est nécessaire mais à deux conditions :
- qu'il ne s'agisse bien que de la psychologie de l'orientation
- qu'il y ait un meilleur équilibre entre la part de la psychologie et celle de la compétence éducative, de la connaissance du monde économique et de l'emploi
Pour Jérôme Chapuisat, la question de fond est donc de savoir "si et comment, une seule personne peut disposer d'une réelle professionnalité, dans un champ aussi ouvert et polyvalent".
Le SNES FSU a considéré comme 'inadmissibles' ces propos :
"c'est parce qu'ils sont psychologues que les COP peuvent appréhender les adolescents en tant que personnes, comprendre ce qui fait blocage et ouvrir des perspectives d'avenir (...)
L'approche du 'psychologique' dont il est question ne peut évidemment se
concevoir contre l'économique et le social mais en l'intégrant (...) On peut penser que cette déclaration étonnante ne vise qu'à préparer l'opinion au transfert des fonctions de COP sur les enseignants."
|